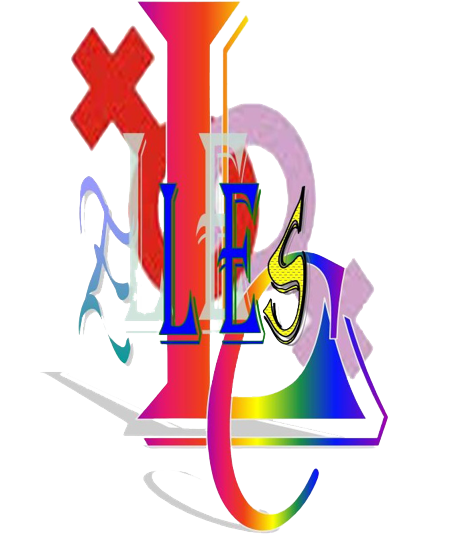L’intersectionnalité, enquête sur une notion qui dérange
L’intersectionnalité, enquête sur une notion qui dérange
1976. Cinq femmes noires portent plainte contre leur employeur, le géant de l’automobile General Motors. La justice américaine, s’appuyant sur les catégories séparées de « genre » et de « race », se révèle incapable de prendre en compte la spécificité de la discrimination qui s’exerce sur elles – elles sont à la fois femmes et noires. C’est précisément pour en rendre raison que Kimberlé Crenshaw, féministe et théoricienne du droit, invente le concept d’intersectionnalité. S’il relève désormais du lexique politique courant aux États-Unis, au sein des luttes féministes ou du mouvement Black Lives Matter, par exemple, il est attaqué de toutes parts en France. D’un côté, on lui reproche son irénisme ou son académisme, de l’autre, son rejet de l’universalisme ou de la lutte des classes. L’intersectionnalité est pourtant avant tout un concept stratégique qui vise à comprendre l’interaction et la relation entre différents modes de domination et à négocier, en les intégrant, à partir des tensions et désaccords qui traversent les luttes.
1C’est sans doute Laurent Bouvet qui exprime le mieux la panique morale qui s’empare de certains intellectuels français dès qu’il est question d’intersectionnalité. Ce concept, écrit-il en effet dans L’Insécurité culturelle, « est utilisé, aujourd’hui, en France – tout particulièrement à gauche – pour justifier les revendications identitaires et culturalistes de minorités en les assimilant à des luttes sociales menées au nom de l’égalité [1][1]L. Bouvet, L’Insécurité culturelle, Fayard, Paris, 2015. ». Selon le politologue, certains chercheurs en sciences sociales et groupes d’activistes français, venus du champ des études de genre et de la lutte contre le racisme tout en se réclamant de la gauche radicale, tenteraient de faire passer leurs engagements culturels et identitaires pour une lutte sociale et de se rattacher ainsi à l’histoire de l’émancipation collective de la gauche. Le concept d’intersectionnalité, parce qu’il mettrait en avant des caractéristiques identitaires (de genre, d’appartenance « raciale », d’orientation sexuelle, etc.) se trouvant à l’intersection de plusieurs formes de discrimination et d’inégalité, permettrait de faire basculer la lutte pour l’égalité du côté d’une politique de l’identité (identity politics) à l’américaine.
L’intersectionnalité, un concept vécu comme une menace antirépublicaine
Il est assez difficile de restituer le raisonnement de Laurent Bouvet si on ne le réinscrit pas dans une visée stratégique. Et il faut donc se reporter aux entretiens, plus spécifiquement politiques, qu’il a pu accorder ici et là. D’une part, le fondateur du Printemps républicain concède que ce qu’il appelle, en en critiquant l’usage, l’« intersectionnalité des luttes » s’inscrit, au moins aux États-Unis, dans un horizon d’égalité et de justice sociale. Il considère que « ce qui est valable aux États-Unis, en raison de la spécificité irréductible de la question noire dans ce pays, apparaît […] comme une instrumentalisation politique [des élites] aujourd’hui en France [2][2]L. Bouvet : « L’exacerbation des figures identitaires est… ». Et il semble même reconnaître une certaine validité aux travaux universitaires américains qui ont contribué à jeter les bases du concept d’intersectionnalité : « La chercheuse et activiste américaine Kimberlé Williams Crenshaw qui en est à l’origine l’a utilisé pour la première fois en 1993 […] pour démontrer que la lutte des femmes noires pour la reconnaissance de leur identité était aussi une lutte sociale. » Mais pourquoi ce qui est légitime aux États-Unis ne le serait-il pas en France ? C’est que, d’autre part, le politologue récuse le terme d’« intersectionnalité des luttes » qui, à ses yeux, tend à associer, dans le contexte français, la question de l’égalité des droits à celle de l’égalité sociale. Rendre acceptables les revendications identitaires et culturelles des minorités en les intégrant à des luttes sociales reviendrait en effet à faire de ceux qui sont discriminés sur une base identitaire de nouveaux dominés qui viendraient usurper la fonction d’émancipation qu’occupait auparavant la classe ouvrière dans la lutte des classes. Cela permettrait aussi, à terme, de faire glisser la légitimité de la lutte sociale pour l’égalité du côté des minorités, mais contre d’autres catégories sociales qui en étaient jusqu’ici les détentrices et les bénéficiaires, notamment les hommes, blancs, hétérosexuels…
3Élargir l’horizon de la lutte pour l’égalité aux minorités de couleur, d’orientation sexuelle, de genre, signifierait donc perdre de vue la spécificité d’un projet d’émancipation de nature républicaine, c’est-à-dire un projet d’émancipation collectif et universel fondé sur la base, et la seule base, de l’égalité sociale : « La difficulté à se projeter dans le “commun” – sans même parler d’universel – vient à la fois du fait que c’est beaucoup plus difficile en période de crise économique et sociale, et aussi du fait qu’une large partie des acteurs politiques et intellectuels qui devraient canaliser les différences vers ce commun ne jouent plus leur rôle. […] Le commun, l’égalité et l’universalisme sont devenus des incongruités pour toute cette gauche. Ces idées apparaissent comme les créations et les instruments de domination d’une “majorité” mâle, blanche, hétérosexuelle, occidentale, etc. Ce qui permet de reléguer la lutte et la dialectique sociales au second plan, d’où ma critique de l’usage fait en France de “l’intersectionnalité des luttes”. Les élites, y compris les intellectuels et les chercheurs de cette gauche identitaire et culturaliste, y trouvent parfaitement leur compte [3][3]L. Bouvet, « Recréer du commun, c’est se remettre à faire de la…. »
4On le voit, l’enjeu, pour Laurent Bouvet, est au fond de redessiner les contours et les frontières d’un projet d’émancipation de gauche. La sphère de l’égalité légitime est définie et constituée à travers un certain type d’exclusion : celle de luttes qui ne sauraient être universelles, et de revendications qui ne sauraient être « communes ». Et cela signifie que la lutte pour l’égalité ne saurait, en bonne logique républicaine, être étendue aux minorités en tant précisément qu’elles sont des « minorités ». Plus généralement, la constitution de ce qui peut devenir, ou non, une politique d’émancipation est soumise à l’impératif d’universalité. Enfin, sont visées les catégories comme les intellectuels et les activistes de la gauche radicale, renvoyés à une forme d’élitisme coupé de tout contact avec les catégories populaires.
Le sens « social » de l’intersectionnalité
5À l’inverse, il est amusant de constater que, durant les dernières primaires démocrates de 2016 qui ont vu s’opposer Hillary Clinton et Bernie Sanders, l’usage du concept d’« intersectionnalité » a parfois fonctionné, dans un sens opposé. Dès février 2016, des articles critiques, parus à la une de Politico [4][4]M. Roberts, « Hillary’s Woman Problem », « Why Millennials…, ont en effet signalé que de nombreuses jeunes femmes, et plus particulièrement des jeunes femmes noires et précaires, se refusaient, contre toute attente, à apporter leur suffrage à Hillary Clinton. Elles furent ainsi 82 %, dans l’État du Vermont, à lui préférer Bernie Sanders. La raison ? Averties des théories de l’intersectionnalité – elles étaient souvent étudiantes et/ou féministes – ou tout simplement plus sensibles aux questions de race et de classe, ces jeunes femmes ne se reconnaissaient pas dans le féminisme blanc, bourgeois et élitiste de la candidate démocrate. Surtout, elles étaient révoltées par l’usage que celle-ci faisait, à l’occasion, du terme « intersectionnel ». Lorsqu’en février 2016, Hillary Clinton s’est présentée à Harlem devant la communauté noire, ou lorsque, sur son compte Twitter, en mars 2016, elle a mentionné des problématiques à caractère « intersectionnel », elle a semblé tout oublier des questions de classe ou de précarité relatives aux femmes ou à la communauté noire. Outre les foudres des jeunes femmes noires et précaires, la candidate démocrate s’est donc logiquement attiré, en réponse, un tweet assez sévère de Kimberlé Crenshaw : « Hillary Clinton invoque l’intersectionnalité, mais sait-elle bien ce qu’elle veut dire par là [5][5]https://twitter.com/sandylocks/status/708036683032346625,… ? »
6Tout s’est donc passé comme si ce qui était reproché à Hillary Clinton, c’était de n’être pas assez intersectionnelle et d’avoir privilégié les questions relatives au genre ou à la race, au détriment des questions de classe ou même, contrairement à Bernie Sanders, des questions écologiques. De façon paradoxale, c’est le sénateur démocrate – pourtant un homme blanc, âgé… – qui est apparu comme le mieux à même de rallier les voix de jeunes femmes précaires et racisées, ainsi que de bâtir, plus généralement, le cadre d’une coalition rassemblant travailleurs blancs, précaires, écologistes et minorités de genre, d’orientation sexuelle ou de couleur. Et c’est Hillary Clinton qui, au contraire, a été renvoyée du côté de l’élitisme d’un féminisme bourgeois coupé des classes populaires et racisées.
7Angela Davis, dans un entretien à Mediapart, a elle aussi relevé le manque de profondeur de cette invocation du concept d’intersectionnalité chez la sénatrice démocrate. Elle y voyait même l’une des raisons, aussi bien intellectuelles que politiques et morales, pour lesquelles Hillary Clinton a finalement été défaite face à Donald Trump. Si la candidate démocrate n’a pas pu, ou su, mobiliser le plein des voix des femmes, et notamment des plus jeunes, précaires ou racisées, c’est, selon A. Davis, qu’elle s’est appuyée « sur une vision dépassée du féminisme fondée sur l’idée que les femmes seraient, sans le dire, considérées comme blanches et issues des classes moyennes. C’est une conception petite-bourgeoise du féminisme qui n’a pas parlé à la majorité des gens, et encore moins à la majorité des femmes. Les féministes les plus vivantes et les plus vibrantes aujourd’hui sont celles qui luttent contre le racisme, le capitalisme et l’homophobie, et qui sont internationalistes ou de tendance marxiste. Clinton aurait pu apprendre beaucoup de la notion d’intersectionnalité [6][6]A. Davis, « Les États-Unis sont en train de vivre une… ».
8De plus, en qualifiant les électeurs les plus modestes de Donald Trump de « déplorables », en s’alarmant sur un mode moral de leurs dispositions à la détestation des femmes, des Noirs et des homosexuels, elle a sans doute renforcé, voire exacerbé ces dispositions. Elle n’a en effet pas su construire au préalable un cadre et un projet politiques intersectionnels susceptibles de se rallier les catégories populaires en dépit de ces dispositions mêmes. Au contraire, il se pourrait même que ses plaidoyers en faveur du féminisme, son adhésion déclarée au combat des homosexuels et des Noirs aient été perçus comme autant de manières de manifester une supériorité morale, bien faite pour repousser et renvoyer les catégories populaires à leurs dispositions sexistes, racistes ou homophobes.
9On voit donc qu’un féminisme de type intersectionnel et le concept d’intersectionnalité en général sont susceptibles de plus d’un usage politique et militant selon qu’ils s’inscrivent dans le contexte français ou américain. Dans un cas en effet, l’invocation de l’intersectionnalité est perçue (chez Laurent Bouvet et consorts en tout cas) comme coupée de tout ancrage dans les luttes sociales et les catégories populaires. Dans l’autre, elle est un instrument théorique qui contribue à radicaliser les luttes des minorités de genre, d’orientation sexuelle ou de couleur dans le sens d’une lutte sociale et politique élargie. Plus généralement, elle divise quant au sens de l’universalité des luttes, soit que celle-ci soit comprise dans un sens étroit ou, au contraire, dans un sens étendu, plus inclusif et vibrant.
10Ces conflits d’interprétation, aussi bien théoriques que politiques, dessinent des projets d’émancipation concurrents. C’est sans doute que les articles fondateurs de K. Crenshaw, et le cadre dans lequel la réflexion sur ce que l’on appelle l’intersectionnalité prend son point de départ, sont hélas encore mal connus, aussi bien en France qu’aux États-Unis, dans les champs politique et intellectuel. Sans doute parce qu’ils ne sont pas encore traduits ou assez largement diffusés, ces articles, partout cités, donnent lieu dès lors à des interprétations contradictoires ou polémiques sans que l’on sache très bien, cependant, quel est leur propos exact [7][7]K. Crenshaw, « Demarginalizing the Intersection of Race and….
Prendre en compte la spécificité des situations de dominations plurielles
11Les articles de K. Crenshaw s’inscrivent pourtant dans un contexte précis et rigoureux : celui d’un commentaire de l’histoire de la législation antidiscrimination américaine. La juriste prend en effet pour point de départ le conflit qui oppose en 1976 cinq femmes noires au constructeur automobile General Motors dans le cadre d’une discrimination au travail. Très vite, il apparaît que la position des femmes noires, irréductible aux grandes catégories juridiques de discrimination officiellement reconnues (le genre et la race, selon la terminologie en vigueur dans le droit états-unien), les empêche de bénéficier des protections qui leur sont associées et attachées. Il s’agit donc, pour celle qui forge à cette occasion le concept d’intersectionnalité, de montrer que si la législation antidiscrimination échoue à prendre en compte les discriminations dont souffrent les femmes noires, c’est que, mettant en œuvre de manière séparée les catégories de genre et de race, elle ne parvient pas à se saisir de l’expérience sociale particulière des femmes noires. Au fond, la justice américaine ne parviendrait pas à rendre raison du fait que les femmes de couleur sont discriminées au travail parce qu’elles sont femmes et noires. Or c’est bien parce qu’elles sont à la fois femmes et noires qu’elles sont plus discriminées que, par exemple, des femmes blanches ou des hommes noirs.
12Au regard de cet enjeu central – ressaisir une expérience sociale particulière qui est plus que la somme de plusieurs discriminations –, on peut donc déjà donner une définition assez simple de l’intersectionnalité. On parle d’intersectionnalité lorsque l’expérience d’une discrimination vient interagir avec, renforcer, ou même exacerber une ou des discriminations déjà présentes. Si une femme noire se situe à l’intersection d’au moins deux discriminations, sa vulnérabilité, socialement unique, résulte à la fois d’une discrimination de race et de genre, qui produit une expérience sociale particulière. Sébastien Chauvin, sociologue et professeur à l’université de Lausanne, au fait des subtilités qui peuvent tromper un lecteur rapide de K. Crenshaw, nous l’explique fort bien en quelques mots lors d’un entretien : il faut « rompre avec les métaphores géométriques associées à l’idée d’“ intersection”, que les théories de l’intersectionnalité avaient initialement pour but de déconstruire, mais à laquelle on les réduit parfois trivialement aujourd’hui [8][8]Il est notamment l’auteur, avec Alexandre Jaunait, d’un article… ».
13Pour la juriste américaine, il ne s’agit de rien de moins que de repenser les dynamiques d’identification et les tensions sociales qui affectent ce que l’on appelle, aux États-Unis, les « politiques de l’identité ». L’effet politique de cadrage sur des identités, des groupes ou des catégories d’individus séparés, comme les femmes, les Noirs, les homosexuels etc., tend en effet à produire des tensions à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur des groupes et des catégories ainsi considérées. Dans le cas qui nous occupe, il s’agit de penser ensemble les conflits entre les femmes blanches et les femmes noires, mais également entre les femmes noires et les hommes noirs. C’est bien en ce sens que K. Crenshaw évoque l’expérience des femmes de couleur accueillies dans les foyers d’hébergement de New York. Il apparaît en effet que les femmes de couleur réfugiées dans ces foyers ne fuient pas seulement la violence conjugale. Plus exposées, en tant que femmes de couleur, au chômage, à la précarité, souvent socialement isolées, elles éprouvent plus de difficultés que les femmes blanches à se loger auprès de relations ou d’amis, comme à payer un loyer.
14En tant que femmes de couleur, elles ont aussi plus de mal à s’adresser aux services sociaux ou à la police : soit que, noires, elles se méfient des forces de l’ordre, soit que, hispaniques, elles affrontent la barrière de la langue. Enfin, noires ou hispaniques, leur maintien dans les foyers d’hébergement appelle également, de la part des travailleurs sociaux, la mise en œuvre de ressources sociales et économiques spécifiques, de manière à les réorienter vers un travail ou une activité indépendante de leur conjoint. De fait, les femmes de couleur subissent le plus souvent violence de genre, violence raciale et violence économique et sociale.
15On ne peut donc pas, comme le voudrait Laurent Bouvet, réduire l’intersectionnalité à une politique de l’identité quand, au contraire, celle-ci constitue une tentative pour en repenser les limites et les difficultés. Le politologue français, volontairement ou non, semble tout à fait négliger le contexte dans lequel s’inscrit la démarche de K. Crenshaw, qui cherche à redéfinir les politiques de l’identité dans un cadre sociologique. Bien plus, dans ce cadre, il devient problématique, pour ne pas dire impossible, d’opposer travailleurs blancs et femmes noires, revendications sociales et sociétales, catégories populaires et populations d’origine immigrée, sauf à passer sous silence de manière plus ou moins consciente la domination économique des femmes noires, qui n’est pas la simple somme de discriminations de genre et de couleur mais constitue bien une expérience sociale particulière.
Un révélateur des tensions dans et entre les groupes
16Comment s’expliquer ces méconnaissances et ces contresens ? Tout se passe comme si les diatribes contre les dérives identitaires et sociétales de l’intersectionnalité dissimulaient en fait, et dissimulaient plutôt mal, une tentative de se réapproprier un privilège épistémologique dans la redéfinition des politiques d’émancipation. Comme le fait remarquer, de manière assez cinglante, la réalisatrice Amandine Gay – chercheuse et auteur du remarquable documentaire Ouvrir la voix – lorsqu’on l’interroge sur la réaction des hommes blancs se réclamant de la gauche : « Dès la visibilisation des afroféministes sur les réseaux sociaux, nos plus grands et premiers détracteurs ont été les hommes blancs de gauche qui considéraient que nous n’étions pas représentatives des femmes noires puisque trop éduquées et trop bien articulées. Dans leur logique raciste, sexiste et classiste, nous étions aussi de fait des bourgeoises, puisque nous savions parler et analyser notre expérience. Classisme donc, puisque les pauvres ne seraient apparemment pas en mesure de produire des réflexions et analyses sur leur condition. Et racisme/sexisme, puisque les Noir-e-s, en particulier les femmes, ne savent pas penser seules, sans l’aide d’un mari ou d’un guide spirituel sur le chemin de la radicalité. Pas de surprise quant à ce bon vieux paternalisme de gauche. »
17On ne saurait donc séparer sans artifice les politiques publiques antidiscriminatoires et les politiques sociales selon les axes d’analyse de la classe d’une part, de la race ou du genre d’autre part. Pas plus qu’on ne saurait, K. Crenshaw y insiste, dissocier les luttes et les mobilisations les unes des autres. La juriste américaine rappelle combien la dissociation des combats féministes et des combats antiracistes tend en effet à provoquer des tensions entre femmes de couleur socialement démunies, et femmes blanches privilégiées. C’est ainsi qu’en 1992, l’expérience d’une coalition de femmes de couleur et de femmes blanches autour d’une organisation de défense des femmes contre les violences domestiques, la New York State Coalition Against Domestic Violence, prit rapidement fin, faute, de la part des femmes blanches, d’une prise en compte des problèmes spécifiques des femmes hispaniques.
18Éloignées des préoccupations de ces dernières concernant les barrières de langue et de classe, les femmes blanches rechignaient à faire place aux femmes de couleur au sein de leurs institutions représentatives et à confier des responsabilités à des déléguées au sein des quartiers hispaniques. La question de l’intersectionnalité repose dès lors la question de la représentation, de la délégation et du privilège social des femmes blanches dans la définition des politiques et des agendas féministes. Mais une vision intersectionnelle ne fait pas seulement éclater la vision socialement utopique d’un groupe unifié, d’un genre ou d’une identité définis comme non conflictuels et homogènes. Elle tend également à reposer la question des tensions et des conflits entre les groupes, ici entre les femmes noires et les femmes blanches, mais aussi entre les femmes noires et les hommes noirs.
19Au printemps 1990, une retentissante affaire, dite du « viol de Central Park » – une jeune femme qui faisait son jogging y avait été victime d’agression sexuelle – enflamma l’Amérique. Très vite, les médias s’en emparèrent, glosant sur les poursuites et la teneur de la peine encourue par le violeur. Un certain Donald Trump, dont K. Crenshaw a détaillé les agissements spectaculaires, s’offrit à cette occasion une pleine page dans les journaux new-yorkais pour réclamer le retour de l’application de la peine de mort. Suivie d’autres du même type dans une partie de la presse, cette déclaration fit craindre aux éditorialistes un embrasement des antagonismes raciaux. C’est qu’il était apparu très vite, dans ce contexte tendu, que toutes ces prises de position étaient racialement codées : l’agresseur de la jeune femme – blanche et appartenant à la upper-class – était en effet un jeune homme noir.
20On retrouvait d’ailleurs dans ces invectives le lexique déshumanisant qui, dans l’imaginaire de l’Amérique blanche, caractérise les jeunes hommes noirs, incarnations d’une virilité menaçante : ils sont tour à tour désignés comme des prédateurs, des sauvages, des fauves se déplaçant en meute. Le propos, ici, ne vise évidemment ni à dédouaner le violeur, ni le viol en général – ni les intimidations ou le harcèlement sexuels. Mais, comme le remarque K. Crenshaw, durant la semaine où intervint le viol de Central Park, on dénombra trente-huit cas de viols dans la seule ville de New York. L’un d’entre eux, particulièrement atroce, ne donna lieu ni à la même couverture médiatique ni à la même indignation, sans doute parce qu’il avait frappé une jeune femme de couleur dans le quartier pauvre de Brooklyn.
21Bien plus : l’effet de focalisation sur l’origine raciale du violeur avait également fait oublier que les auteurs de viols encourent des peines différentes selon que – du moins aux États-Unis – la victime est une femme noire, hispanique ou blanche. Un homme reconnu coupable du viol d’une femme blanche encourt ainsi en moyenne dix ans de prison, contre cinq et deux ans pour une femme hispanique ou noire. Au regard de l’histoire des statistiques de condamnations pour viol aux États-Unis, tout se passe donc comme si celui d’une femme noire avait un caractère secondaire. Et comme si comme si le viol à caractère intraracial était moins dramatique que le viol interacial.
22Comment s’expliquer cette disparité ? Afin d’en rendre raison, il faut déplacer le cadre d’interrogation vers le cas des jeunes femmes noires victimes de viol. Celles-ci, en tant que femmes et en tant que noires, sont non seulement victimes de viol, mais également passibles, dans le contexte judiciaire américain, d’interrogations et d’enquêtes sur leur passé sexuel supposé. Les jeunes femmes noires, parce qu’elles sont réputées avoir une conduite sexuelle complaisante, voire provocante, et consentir plus aisément à l’acte sexuel que les jeunes femmes blanches, sont en effet immédiatement rangées, dans l’imaginaire américain, du côté des femmes « faciles ». En un mot : du côté de la « putain » (whore) plutôt que de la « maman » (madonna).
23On ne peut donc prendre la pleine mesure du racisme et du sexisme qu’en considérant l’expérience des jeunes femmes noires victimes de viol. Celles-ci sont, en un sens, plus racialisées encore que les hommes noirs (elles symbolisent le tout de l’attractivité sexuelle des Noir-e-s). Et, en un autre sens, elles sont plus genrées que les femmes blanches (elles incarnent le tout de la dangerosité sexuelle des femmes). La législation antiviol et les politiques féministes blanches qui visent à la renforcer échouent ainsi, faute de s’interroger sur un ordre sexuel et genré qui est aussi un ordre racial, à questionner et à faire travailler ensemble des catégories discriminatoires qui sont pourtant opérantes dans l’expérience des jeunes femmes noires. Tout comme, les politiques antiracistes, se focalisant sur le cas des jeunes hommes noirs, tendent à marginaliser toute interrogation sur la domination de genre et sexuelle à l’intérieur de la communauté noire.
24Les jeunes femmes noires ou, plus largement, les minorités de genre racisées, doivent en effet encore affronter des problématiques internes aux communautés noires ou, plus largement, racisées. La double subordination des femmes de couleur tend en effet à engendrer des dilemmes ou des conflits subjectifs, par exemple autour de la question de savoir si les femmes noires peuvent et doivent s’associer à des politiques féministes antiviol quand celles-ci opèrent, en fait, au seul profit des femmes blanches et au détriment des hommes noirs. Cette question est d’autant plus sensible que, comme le rappelle K. Crenshaw, l’incrimination des hommes noirs pour viol, du moins dans le contexte de l’histoire américaine, a longtemps fonctionné comme un instrument de légitimation de la mise en accusation générale des hommes noirs. Et cela sans que, le plus souvent, le viol des femmes blanches ait été déterminé comme imputable à un homme noir, ou tout simplement avéré. Du reste, comme le relève l’historien Todd Shepard, le même effet de focalisation sur la virilité menaçante des hommes de couleur existe dans les sociétés coloniales et postcoloniales européennes, avec le même effet de cadrage, là encore, sur la question du viol des femmes blanches [9][9]T. Shepard, Mâle décolonisation. L’« homme arabe » et la….
De l’expérience singulière des hommes transgenres et racisés
25Comment, dès lors, se rallier à des politiques féministes sans pour autant favoriser ou même soutenir des politiques racistes ? Cela oblige à opérer une double rupture : avec un féminisme racialiste, d’une part, un antiracisme androcentré, d’autre part. C’est ici que l’expérience des hommes transgenres et racisés se révèle cruciale. Bien placés pour avoir pu observer tous les privilèges associés à la masculinité dans les communautés racisées (pouvoir quitter le domicile familial sans autorisation, se sentir en sûreté dans la rue, etc.), mais conscients également de la focalisation raciale sur la sexualité des jeunes hommes noirs, les hommes transgenres racisés témoignent d’une aptitude particulière à percevoir la double contrainte qui s’exerce sur les femmes racisées.
26Joao Gabriell, transgenre, bloggeur et écrivain afro-caribéen très suivi sur les réseaux sociaux, en sait quelque chose. Alors qu’on l’interroge sur l’idée d’agir lors de la marche des fiertés LGBT pour mettre au centre du débat et des revendications la nécessité de protéger les femmes trans de couleur, alors victimes, de manière croissante, de viols et d’assassinats aux États-Unis comme en France, celui-ci récuse, dans l’immédiat, cette perspective. S’il reste ouvert à des alliances futures avec l’ensemble de la communauté LGBT, il pointe les doubles discriminations dont sont victimes les transgenres de couleur à l’intérieur d’une communauté largement dominée, de fait, par des hommes gays, blancs et cisgenres (c’est-à-dire des personnes dont le genre vécu correspond à celui qui leur est assigné, à la naissance, par la médecine et l’état civil). Et il plaide, avant toute alliance possible, pour une autonomie des luttes particulières, en rappelant que des combats comme celui d’Act-Up s’étaient d’abord bâtis, avant de s’élargir, sur la base d’une double discrimination singulière, à savoir l’homosexualité et la séropositivité.
27Il refuse donc ce qu’il appelle l’« impératif de la convergence des luttes », au moins comme préalable à l’autonomie relative d’une lutte spécifique – ce qui ne signifie pas, bien entendu, que cette autonomie exclue toute possibilité d’alliance sur des points déterminés et essentiels, pour peu qu’ils donnent lieu à des négociations. En tant qu’homme transgenre de couleur, il est également sensible à la rupture radicale que représentent potentiellement des mobilisations de femmes de couleur qui ne seraient façonnées ni par les femmes blanches ni par les hommes noirs : « Les mobilisations de féministes, queers et trans non blancs » portent en elles un projet de déstabilisation du féminisme blanc « dès lors qu’elles affichent fièrement la rupture avec le rôle qui leur est assigné ». Bien plus, affirme toujours Joao Gabriell – il se réfère notamment à La Marche de la dignité et contre le racisme, conduite en octobre 2015 par des femmes de couleur –, c’est « à travers le féminisme non blanc, en rupture avec le féminisme hégémonique que certaines personnes non blanches se forment à la lutte antiraciste, puis décoloniale, qu’elles n’auraient pas rejointe dans sa forme généraliste. Donc le féminisme non blanc est parfois une porte d’entrée pour la lutte décoloniale ».
28La reconnaissance préalable des différences et des conflits au sein d’un groupe serait, ainsi, inséparable de la gestion des tensions entre groupes. Il y a toujours d’autres luttes dans la lutte et il faut négocier avec la multiplicité et la disparité des luttes. Il arrive pourtant que, filant la métaphore de l’intersection, K. Crenshaw soit amenée à écrire que tout se passe comme si, dans l’expérience subjective des femmes noires américaines, les discriminations de genre et de couleur « convergeaient » – ce qui pourrait laisser imaginer, à première vue, que les revendications des hommes noirs ou des femmes blanches devraient s’effacer devant l’expérience singulière et la parole des femmes noires. La juriste invite même à « démarginaliser » cette expérience singulière, pour la placer « au centre » de ses interrogations critiques sur le féminisme.
Des coalitions plus que des convergences de luttes
29Seulement, et il faut être ici attentif à la prudence du geste, c’est pour aussitôt inviter à décentrer la question de l’intersection de la race et du genre, et donc des femmes noires, vers d’autres questions, notamment sociales. L’intersectionnalité, affirme-t-elle, désigne tout au plus un « concept par provision » (a provisional concept) qui, si on l’interroge de plus près, ne saurait constituer et fonder une « théorie totale et achevée ». Au contraire, la théorie de l’intersectionnalité invite à « étendre le féminisme dans le sens d’une inclusion, dans l’analyse, de l’appartenance raciale ou d’autres facteurs comme la classe, l’orientation sexuelle ou l’âge ». Et c’est bien en ce sens que K. Crenshaw invite à penser ce que pourrait être une politique de l’intersectionnalité, plus inclusive et élargie qu’une convergence des luttes, bâtie autour d’une expérience et d’une identité définie comme centrale, ici celle des femmes noires.
30Mais si nos identités sont toujours construites à l’intersection d’au moins deux dimensions, deux catégories sociales, cela signifie-t-il pour autant que nous ne pouvons plus parler d’identités collectives ? Et, par conséquent, de politiques de l’identité ? Non, affirme K. Crenshaw lorsque, par mail, elle prend le temps de répondre à nos questions. Cela revient seulement à imaginer que « les groupes auxquels nous appartenons sont en réalité des coalitions, ou du moins des coalitions potentielles en voie de formation. Bien plutôt, l’intersectionnalité est une base pour repenser l’appartenance raciale comme une coalition des hommes et des femmes de couleur ». De la même manière, « on pourrait reconsidérer l’appartenance raciale comme une coalition des hétérosexuels et des homosexuels de couleur, et ceci constituerait une base pour une critique des institutions ecclésiastiques et culturelles qui contribuent à la reproduction de l’hétérosexisme ».
31Il s’agit donc moins de placer au centre de l’analyse critique – et des luttes – l’expérience d’un groupe particulier – comme autrefois le prolétariat dans le cadre de la lutte des classes – que de créer un nouveau cadre de coalition dans lequel il serait possible de négocier un maximum de différences à l’intérieur des groupes, d’une part, et entre les groupes, d’autre part. Il faut en effet considérer qu’un groupe, une identité collective, sont toujours déjà le produit de transactions, de négociations, de conflits entre différences à l’intérieur du groupe. C’est même, comme nous invite à y réfléchir l’historienne et féministe Joan Scott lors d’un échange de mails sur cette question, ce qui devrait nous conduire à nous méfier des accents consensuels parfois associés (à tort) à la théorie de l’intersectionnalité. Pour sa part, l’historienne féministe – qui a très largement contribué à penser le genre comme concept propre à faire éclater l’unité d’une histoire des femmes – ne se reconnaît pas dans les termes d’une analyse intersectionnelle. Elle reconnaît sans doute que « les questions d’appartenance raciale et de classe doivent faire partie de toute enquête et recherche féministe ». Pour autant, citant Maria Carbin et Sara Edenheim, elle reste « sceptique quant à la manière dont le terme d’intersectionnalité fonctionne comme un “signifiant créateur de consensus” ».
32De la même façon, Wendy Brown, professeure de sciences politiques à l’université de Berkeley, reste attentive à la manière dont nos subjectivités sont formées dans le cadre de tensions entre des formes d’allégeance à des identités collectives conflictuelles. Elle affirme ainsi que si « la construction d’un sujet ne s’élabore pas autour d’axes distincts comme la nationalité, l’appartenance raciale, la sexualité, le genre ou la classe », c’est que « ces allégeances [powers] ne sont pas séparables du sujet lui-même ». Un sujet étant toujours déjà constitué d’allégeances en conflit, « ces allégeances ne sont pas intersectionnelles dans la formation même du sujet [10][10]W. Brown, « The Impossibility of Women’s Studies », in… ». Autrement dit, nous ne pouvons savoir et décider à l’avance de quelle manière un sujet peut être amené à s’identifier, à se reconnaître dans, à choisir telle allégeance et telle appartenance plutôt qu’une autre. Et s’il est même possible qu’un sujet puisse jamais les faire cohabiter sans conflit au sein d’une même expérience.
33Au fond, si l’on tient compte de ces critiques, la question de l’intersectionnalité devrait nous amener à reposer la question de la coexistence d’identités hétérogènes chez un même individu et à considérer que celles-ci, sauf à les traiter comme de pures abstractions, ne sauraient simplement cohabiter entre elles dans la vie, l’expérience et les pratiques ordinaires des individus. Comme le dit S. Chauvin : « S’il n’y rien à “intersecter”au niveau des acteurs concrets, il n’empêche que ces derniers se démènent avec les effets de réel de ces cadrages sociologiques et juridiques, que ce soit dans leurs interactions quotidiennes, dans leurs stratégies biographiques ou dans les formulations plus abstraites de la politique et du droit. Revenir aux acteurs concrets ne signifie donc pas négliger ces contraintes symboliques mais décrire comment une bonne part de la vie sociale consiste à jongler avec les abstractions qui, comme tous les faits sociaux, ont des effets bien réels. »
34C’est dire aussi que nous ne pouvons savoir à l’avance quel axe d’analyse ou de perception sera plus décisif qu’un autre dans la prise en compte d’un événement, d’une mobilisation sociale ou même dans la formulation d’un choix électoral. Le concept d’intersectionnalité, parce qu’il enregistre l’irréductibilité des tensions entre race, classe et genre (pour ne parler que de ces axes d’analyse), tend donc à questionner, mais également à redéfinir les cadres traditionnels de coalition qui fixaient et déterminaient jusqu’ici les relations entre communautés et individus. C’est ainsi qu’aujourd’hui, deux des trois fondatrices du mouvement Black Lives Matter se définissent également comme queers, et le revendiquent de manière déterminée. Dans le mouvement antiraciste qui a bousculé l’Amérique et le Parti démocrate, on peut désormais « être qui on veut », déclare Johnetta Elzie. « On ne cache pas ceux qui ne correspondent pas au modèle de leadership stéréotypé. Il y a des trans noirs qui se battent pour leur propre libération et nous forcent à aborder l’intersectionnalité [11][11]R. Diallo, « Black Lives Matter : un nouveau souffle pour les…. »
35Et si le mouvement Black Lives Matter s’inscrit bien évidemment dans le sillage et l’héritage du Mouvement pour les droits civiques, il interroge aussi la place de l’identité masculine noire – au centre, pourtant, du mouvement de protestation noir, puisque Black Live Matters est apparu sur la scène américaine suite à la mort, en 2014, de deux jeunes hommes afro-américains : Michael Brown à Ferguson et Eric Gardner à New York. Ainsi, de jeunes activistes noirs et homosexuels comme Ricarrdo Valentine et Orlando Hunter, un couple de danseurs, fustigent désormais sans détour le « fondamentalisme » qui éloigne « les queers des églises ». Ou se disent, au contraire, « très heureux et enthousiastes de voir des LGBTQ ou des femmes aux avant-postes du mouvement Black Lives Matter, alors que personne ne sait que le Mouvement pour les droits civiques était soutenu par des queers ».
36Autrement dit, une vision et une pratique intersectionnelles consistent à comprendre l’interaction et la relation entre différents modes de domination tout en refusant, autant que possible, de hiérarchiser les différences et les identités. Comme le dit Angela Davis : « Il n’y a pas d’abord l’exploitation de classe, suivie par la domination de genre, puis par les inégalités raciales. » La question adressée à une politique de l’identité par une vision intersectionnelle n’est donc pas de savoir si un groupe échoue, ou non, à dépasser ses différences internes, mais de savoir s’il approfondit et négocie assez ces différences pour réduire, en pratique, les tensions et les conflits internes au groupe mobilisé. C’est pourquoi Angela Davis définit le mouvement Black Live Matters comme un « exemple » : « Le mouvement Black Lives Matter, qui a gagné en puissance au cours des dernières années aux États-Unis, a été critiqué comme ne prenant la défense que d’un seul groupe. Or c’est le contraire qui se passe. […] L’appellation Black Lives Matter porte en elle une singularité diverse, qui conduit à produire un universalisme plus vibrant, un universalisme qui ne cherche pas à effacer les différences. Black Lives Matter fait explicitement référence aux personnes qui se situent tout en bas de l’échelle sociale. Implicitement, ce sont toutes les personnes subissant une forme d’exploitation qui sont concernées. […] Ses militants reconnaissent qu’attirer l’attention sur les vies des Noir-e-s est un appel à attirer l’attention sur toutes les vies. C’est tout le problème : dès qu’on utilise le terme “Noir”, on suppose que ça rétrécit la discussion. Que la question posée est trop spécifique. Mais c’est en se concentrant sur les spécificités que l’on parvient à une vision plus riche de l’universel [12][12]A. Davis, « Les États-Unis sont en train de vivre une…. »
37C’est en ce sens encore, sans doute, qu’une vision intersectionnelle des relations entre les minorités tend à défaire, mais également à redéfinir, les contours des cadres de coalitions qui avaient fait les beaux jours d’une Amérique arc-en-ciel – une Amérique généreuse, pilotée par le Parti démocrate et composée de l’alliance des minorités de genre, de race, d’orientation sexuelle, qui auraient en partage, avec les travailleurs blancs, un idéal commun de justice sociale. Au regard de l’idée d’une société arc-en-ciel portée par Jesse Jackson (pasteur noir et candidat aux primaires démocrates en 1984 et 1988), plus ou moins bien mise en œuvre, par la suite, sous la présidence de Barack Obama, le sens de l’idée d’intersectionnalité se présente à la fois comme plus exigeant et plus prometteur. Plus exigeant, puisque la notion déstabilise l’évidence de relations qui, entre communautés et à l’intérieur de ces communautés, iraient de soi, ne seraient pas problématiques ou conflictuelles. Mais plus prometteuse aussi, puisque, si elle invite à reconsidérer plus rigoureusement ces relations, elle invite également (pour reprendre le beau mot de K. Crenshaw) à repenser ces relations problématiques comme autant de nouvelles « alliances » possibles.
Notes
- [1]L. Bouvet, L’Insécurité culturelle, Fayard, Paris, 2015.
- [2]L. Bouvet : « L’exacerbation des figures identitaires est d’abord une construction des élites », Philitt, fév. 2015.
- [3]L. Bouvet, « Recréer du commun, c’est se remettre à faire de la politique », Le Comptoir, fév. 2015.
- [4]M. Roberts, « Hillary’s Woman Problem », « Why Millennials don’t Care that Hillary Clinton is a Woman », Politico, fév. 2016 ; cf. aussi C. Foran, « Hillary Clinton’s Intersectional Politics », The Atlantic, mars 2016.
- [5]https://twitter.com/sandylocks/status/708036683032346625, 10 mars 2016.
- [6]A. Davis, « Les États-Unis sont en train de vivre une contre-révolution », Mediapart, nov. 2016.
- [7]K. Crenshaw, « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex. A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics », University of Chicago Legal Forum, n° 140, 1989 ; « Mapping the Margins. Intersectionality, Identity Politics and Violence Against Women of Color », Stanford Law Review, vol. 43, n° 6, 1991. Ce dernier article a toutefois été remarquablement traduit par Oristelle Bonis sous le titre « Cartographies des marges. Intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur » dans les Cahiers du genre, n° 39, 2005.
- [8]Il est notamment l’auteur, avec Alexandre Jaunait, d’un article fondamental intitulé « L’intersectionnalité contre l’intersection », Raisons politiques, n° 58, 2015.
- [9]T. Shepard, Mâle décolonisation. L’« homme arabe » et la France, de l’indépendance algérienne à la révolution iranienne, Payot, Paris, 2017.
- [10]W. Brown, « The Impossibility of Women’s Studies », in Edgework. Critical Essays on Knowledge and Politics, Princeton University Press, Princeton, 2005.
- [11]R. Diallo, « Black Lives Matter : un nouveau souffle pour les voix des Noirs », Libération, 28 mai 2016.
- [12]A. Davis, « Les États-Unis sont en train de vivre une contre-révolution », loc. cit.
Mis en ligne sur Cairn.info le 19/09/2018https://doi.org/10.3917/crieu.007.0066